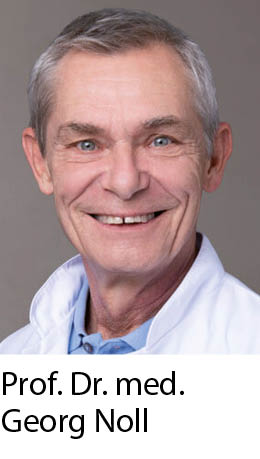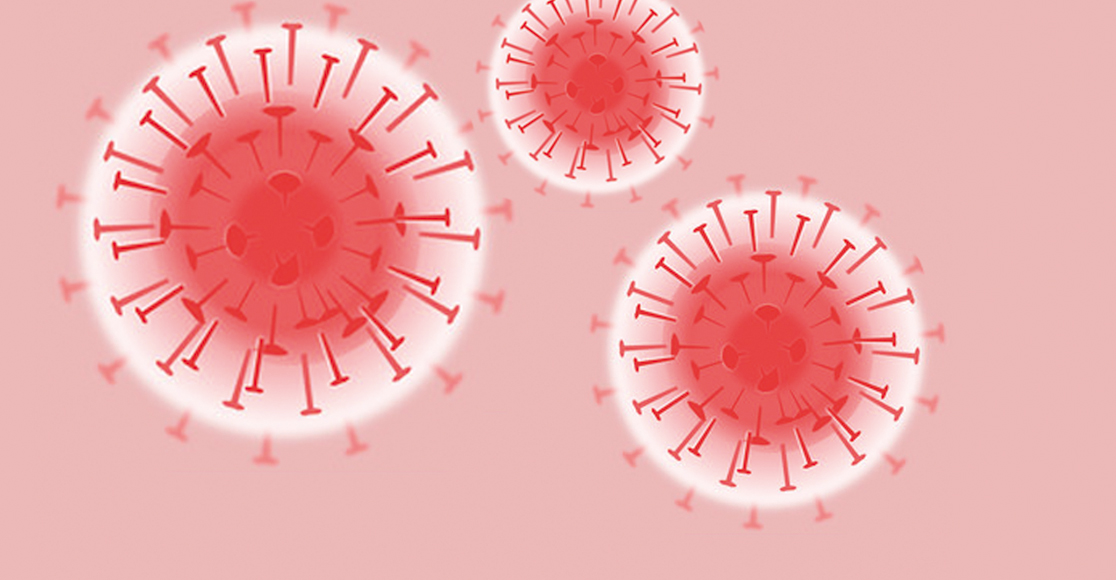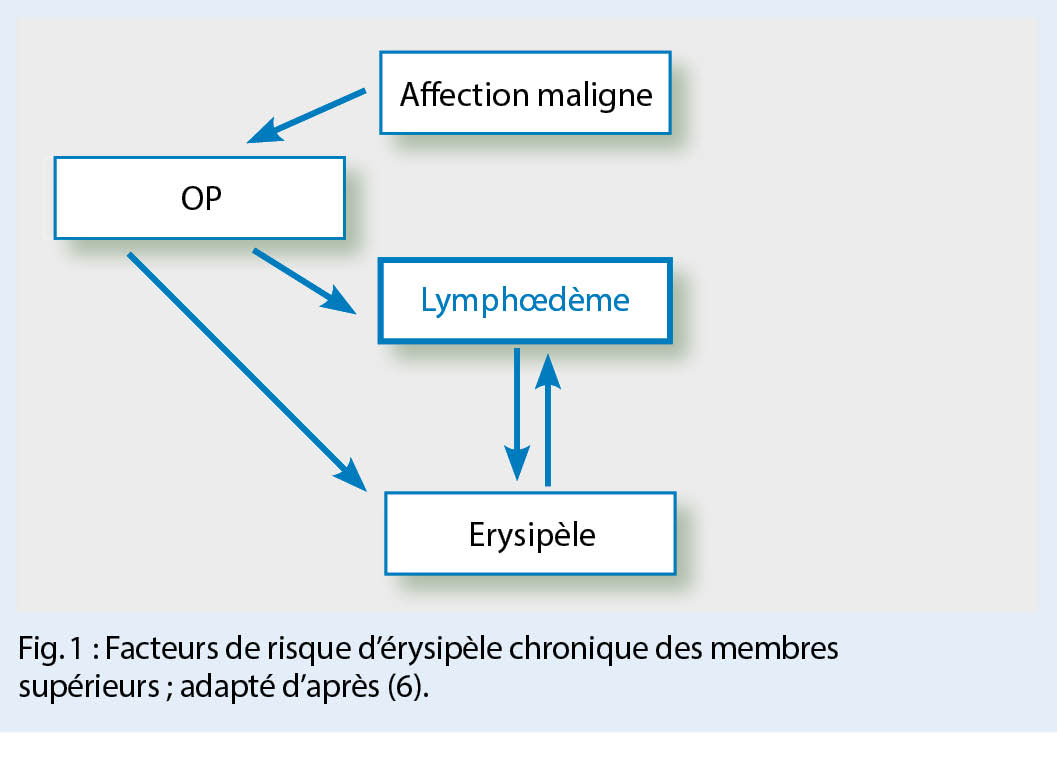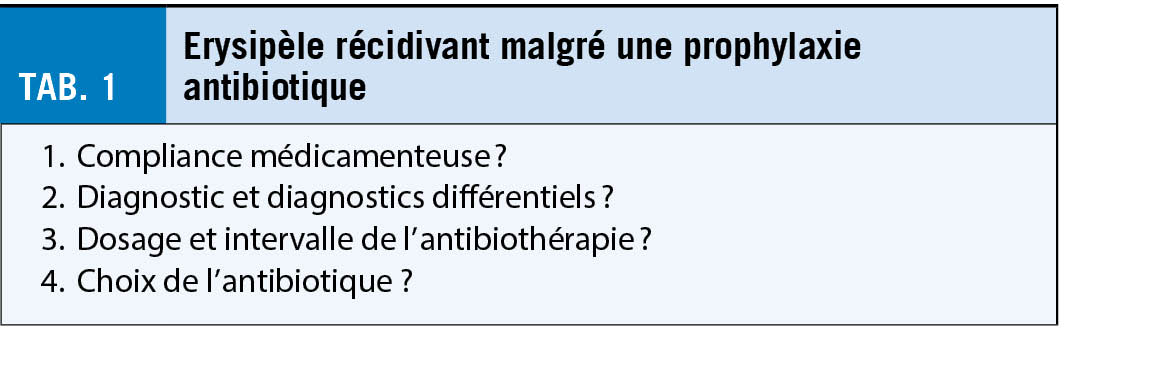Das Cardio & Metabolic Update Meeting für Hausärzte, welches mehrere Male online durch die Firma Medworld durchgeführt wurde, fand sehr regen Anklang. Es waren stets mehr als 80 Personen live zugeschaltet. Zwei ausgewiesene Referenten berichteten über Erfahrungen aus der Praxis mit NOAKs und wie mehr Patienten die in den neuen Richtlinien definierten Cholesterinwerte erreichen können.
NOAKs – Empfehlungen aus der täglichen Praxis
Einleitend wies PD Dr. med. Alexander Breitenstein, Universitätsspital Zürich, auf eine kürzliche Publikation hin (1), der neuesten Version einer Anleitung, wie im Alltag mit den nicht Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulantien umgegangen werden kann.
Er präsentierte die Flow Chart der Vorgehensweise beim Vorhofflimmern, wie sie in den ESC-Guidelines im letzten Jahr vorgeschlagen wurde (2). Diese soll zu einer Entscheidung für oder gegen eine orale Antikoagulation bei Vorhofflimmern führen. Die Entscheidung gründet einerseits auf dem CHA2DS2-VASc-Score zur Erfassung des Stroke-Risikos und andrerseits auf dem HAS-BLED-Score zur Erfassung des Blutungsrisikos. Die Entscheidung geht heutzutage direkt zu den nicht Vitamin-K-abhängigen direkten oralen Antikoagulantien (NOAKs), die gegenüber den Vitamin-K-Antagonisten heute präferentiell eingesetzt werden. Es wird nicht unterschieden, ob das Vorhofflimmern paroxysmal ist oder permanent. Es gibt zwar Daten aus grossen Registerstudien, die darauf hindeuten, dass Patienten mit paroxysmalem Vorhofflimmern ein potentiell geringeres Risiko für Hirnschläge haben. Das zeigt sich auch bei der Mortalität (3). Die Gabe der Antikoagulation in Abhängigkeit der Häufigkeit des Vorhofflimmerns wurde aber nie randomisiert untersucht. Daher ist dies in den Guidelines auch nicht enthalten. Für die Entscheidungsfindung für oder gegen eine Antikoagulation zählt die Häufigkeit des Vorhofflimmerns nicht.
NOAKS versus Vitamin-K-Antagonisten
Der Referent erwähnte kurz die Gerinnungskaskade und erinnerte daran, dass die Vitamin-K-Antagonisten mit der Produktion von gewissen Gerinnungsfaktoren interagieren, während die NOAKS mit den bereits gebildeten aktivierten Substanzen interagieren. Es gibt die direkten Faktor-Xa-Hemmer, die Xabane (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban) und den direkten Thrombinhemmer, das Dabigatran. Jede von diesen 4 Substanzen ist in grossen Untersuchungen mit über 10’000 Patienten gegenüber Vitamin-K-Antagonisten untersucht worden. In Bezug auf Effektivität sowie Schutz vor einem Hirnschlag oder einer systemischen Embolie waren die NOAKs mindestens ebenso gut wie die Vitamin-K-Antagonisten oder sogar besser. Der Durchbruch kam aber dadurch, dass die Sicherheit mit den NOAKs höher war. Es wurden weniger Blutungen festgestellt. Dies gilt vor allem für die gefürchteten intrakraniellen Blutungen, die massiv geringer und klinisch relevant weniger häufig auftraten. Diese Daten aus randomisierten Studien konnten mittlerweile auch in grossen Registern, also bei Patienten, wie sie im klinischen Alltag gesehen werden, bestätigt werden. Ein Vergleich in Schweden des Jahres 2012, wo vor allem Vitamin-K-Antagonisten eingesetzt wurden, mit dem Jahr 2017, wo man praktisch vollständig auf NOAKs umgestellt hatte, zeigt unabhängig vom Alter und vom CHA2DS2-VASc-Score eine signifikant tiefere Rate an Hirnschlägen im Jahr 2017 als im Jahr 2012. Aber auch die Blutungsrate war im Jahr 2017 signifikant niedriger als im Jahr 2012 (4).
Eine andere Frage ist, was die Patienten von einer oralen Anti-koagulation erwarten. Dabei hat sich gezeigt, dass etwa 60% der Patienten sowohl einen guten Schutz vor Hirnschlägen als auch ein geringes Risiko für Blutung wünschen, wobei dies mit zunehmender Kenntnis über Hirnschlag zunahm (5). Für die Patienten zählt also beides: Hirnschlagprävention und möglichst wenige Blutungen zu bekommen. Darauf ist man in den vergangenen Jahren vermehrt eingetreten, indem man diese beiden gesonderten Endpunkte, ischämische Events und Blutungsevents nun zusammen im sogenannten «net clinical benefit» betrachtet. Auch das hat man für die NOAKs untersucht, wobei der Nettonutzen für die NOAKs noch höher war als der Benefit für die einzelnen Endpunkte (6).
Das Blutungsrisiko
Dieses hat wieder eine grössere Bedeutung erhalten. Die Risiko-stratifikation beim Vorhofflimmern für oder gegen eine Antikoagulation richtet sich einzig nach dem CHA2DS2-VASc-Score. Gleichzeitig soll das Blutungsrisiko mit dem HAS-BLED-Score ermittelt werden. Dieser wurde nie in einer randomisierten Studie untersucht, um eine Antikoagulation zu verhindern. Das Ziel seines Einsatzes ist nicht die Verhinderung einer Antikoagulation, sondern das Ermitteln von Faktoren, die das Blutungsrisiko erhöhen, damit diese eliminiert werden können. Zu diesen Faktoren gehören das Alter, der Blutdruck, Status nach Hirnschlag, Status nach Blutung oder Prädisposition für Blutung, labiler INR, Medikamente (NSAR, ASS etc.), Alkohol- oder Medikamentenabusus.
Spezielle Aspekte
- Gastrointestinale Blutungen
Der Durchbruch der NOAKs kam mit der erhöhten Sicherheit, d.h. mit weniger relevanten Blutungen. Das muss leicht relativiert werden, weil zumindest die Anzahl der gastrointestinalen Blutungen bei gewissen Untersuchungen höher war. Die Studien können aber nicht direkt miteinander verglichen werden, weil es sich um unterschiedliche Populationen gehandelt hat. Sowohl der CHA2DS2-VASc-Score ist unterschiedlich als auch das Blutungsrisiko. Die Tendenz zu mehr gastrointestinalen Blutungen hat sich aber auch in Metanalysen bestätigt (7). Die Anzahl der grossen Blutungen war aber unter NOAKs geringer als unter Vitamin-K-Antagonisten. Die Empfehlung lautet, dass Faktoren, die zu vermehrten Blutungen führen, eliminiert werden sollten. Falls dies nicht möglich ist, muss man sich die Frage stellen, ob man eine Antikoagulation wieder beginnen soll oder nicht. Wenn solche Faktoren nicht vorhanden sind, kann man mit einer Antikoagulation nach einer gewissen Zeit wieder beginnen. - Antikoagulation bei extremen BMI-Werten
Die NOAKs funktionieren eigentlich bei allen BMI-Werten. Weder beim Risiko für Hirnschläge noch bei den Blutungen gab es einen statistisch signifikanten Unterschied (1). NOAKs können also bei BMI 17-40 mit gutem Gewissen in der empfohlenen Dosierung verwendet werden. Bei höheren BMI-Werten kann man einen Wechsel zu Vitamin-K-Antagonisten oder die Messung der Plasmaspiegel der NOAKs diskutieren. Dies gilt auch für besonders niedrige BMI-Werte. - Antikoagulation bei der älteren Population
Die Zulassungsstudien der 4 NOAKs haben durchwegs gezeigt, dass die über 75-Jährigen noch mehr von einer Antikoagulation mit NOAKs profitieren als die unter 75-Jährigen. Bei den Blutungen hält es sich etwa die Waage. Der «net clinical benefit» kommt bei den über 75-Jährigen mehr zum Tragen als bei den Jüngeren.
Fazit
Der Schutz vor Hirnschlag bei Vorhofflimmern hat oberste Priorität
Heutzutage empfohlen durch Einsatz nicht Vitamin-K-abhängiger oraler Antikoagulantien (Klasse-IA-Empfehlung)
Thrombotische und Blutungs-Ereignisse nicht getrennt sehen → Beides bringt für unsere Patienten ein Handicap
Grösserer Nutzen je höher das Risiko ist (u.a. bei der älteren Bevölkerung)
Wie können mehr Patienten die Cholesterin-Zielwerte erreichen?
Die Atherosklerose ist immer noch der Killer Nr. 1 im fortgeschrittenen Alter, auch in der Schweiz, wie die Zahlen des Bundesamts für Statistik belegen, so Prof. Dr. med. Georg Noll, Hirslanden Klinik Zürich.
Die Atherosklerose ist ein lebenslanger Prozess. Das Gefäss verändert sich, es kommt zur endothelialen Dysfunktion. Es bilden sich atheromatöse Plaques, die Cholesterin enthalten. Diese Cholesterinablagerungen führen zu funktionellen und strukturellen Gefässveränderungen. Symptomatisch werden die Patienten, wenn die Gefässverengung etwa 50% des Lumens entspricht. Ein akutes Koronarereignis erfolgt, wenn die Plaques rupturieren, wodurch die Gerinnung aktiviert wird und es zu einer Thrombusbildung kommt. Dabei spielen auch Entzündungsfaktoren eine Rolle. Wir wissen, dass die Atherosklerose von Risikofaktoren abhängt, so der Referent. Cholesterin spielt dabei eine wesentliche Rolle. In der INTERHEART-Studie (5) erhöhte das Verhältnis Apo B/Apo A-I, welches ungefähr LDL-C/HDL-C entspricht, das kardiovaskuläre Risiko 3.3-fach bei Patienten, die von diesem Risikofaktor betroffen sind.
Globales Risiko und Zielwerte
In den Richtlinien wird jedoch nicht nur die Berücksichtigung eines einzelnen Risikofaktors empfohlen, sondern die Erfassung des globalen Risikos. Die Arbeitsgruppe Lipide und Atherosklerose der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie hat die jeweiligen Empfehlungen der Europäische Gesellschaft für Kardiologie für die Schweiz adaptiert und in Pocket Guides wiedergegeben. Entsprechend dem globalen Risiko werden 4 Risikokategorien definiert: Sehr hohes Risiko, hohes Risiko, moderates Risiko und niedriges Risiko. Die Erfassung des Risikos bestimmt auch die Therapie. In den im letzten Jahr neu aufgelegten Guidelines der Europäischen Gesellschaften für Kardiologie und Atherosklerose (8) wurden neue Zielwerte aufgrund verschiedener klinischer Studien festgelegt: für sehr hohes Risiko ein LDL-C-Wert < 1.4 mmol/l, für hohes Risiko < 1.8mmol/l, für moderates Risiko < 2.6 mmol/l und für niedriges Risiko < 3.0mmol/ und jeweils eine LDL-Cholesterinreduktion um mindestens 50%, wobei in der Niedrigrisikokategorie vor allem Lebensstiländerungen zur Erreichung dieser Werte empfohlen werden. Das 10-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse für die nächsten 10 Jahre kann mit dem AGLA-Risikorechner (AGLA.ch) einfach abgeschätzt werden.
Patienten mit sehr hohem und hohem kardiovaskulärem Risiko
Wichtig ist, dass diese Patienten identifiziert werden. Vor allem die mit einer klinisch manifesten Atherosklerose, also Patienten mit kardiovaskulären Ereignissen, einem Myokardinfarkt oder Stroke, aber auch Patienten mit einer familiären Hypercholesterinämie. Die familiäre Hypercholesterinämie wird in der Schweiz noch ungenügend diagnostiziert. Der Referent wies darauf hin, dass bei Patienten, die LDL-C-Werte über 5mmol/l aufweisen, alle Verwandten mindestens ersten Grades ebenfalls getestet werden sollten. Eine schwere Niereninsuffizienz (eGFR < 30) und Diabetes mit einem Endorganschaden oder zusätzlich 3 weiteren Risikofaktoren oder einem seit mehr als 20 Jahre vorhandenen Diabetes Typ 1 sind ebenfalls mit einem sehr hohen Risiko vergesellschaftet. Patienten mit hohem Risiko müssen noch nicht symptomatisch sein. Es handelt sich um Patienten, die eine in der Bildgebung dokumentierte Atherosklerose haben, beispielsweise in der Koronarcomputertomographie, einem heute äusserst sensitiven Verfahren, das eine genauere Erfassung atherosklerotischer Veränderungen erlaubt.
Patienten mit einer markanten Erhöhung eines einzelnen Risikofaktors, wie z.B. Cholesterin über 8mmol/l oder ein LDL-C über 5mmol/l, haben ebenfalls ein sehr hohes Risiko. Für sie gilt die Erfassung des globalen Risikos mittels Scores nicht.
Medikamentöse Therapie
Medikamente sind nicht das Allerheilmittel, betonte der Referent. Wichtig ist, dass wir den Patienten Lebensstiländerungen empfehlen, v.a. Aufgabe des Rauchens und vermehrte körperliche Aktivität, aber auch diätetische Änderungen: weniger Salz, mehr Gemüse und Früchte, Fisch 2x pro Woche und insbesondere 30g Nüsse pro Tag. Alkohol ist nicht empfohlen, aber erlaubt.
Bei starken LDL-C-Erhöhungen und hohem kardiovaskulärem Risiko sind Lebensstiländerungen indessen ungenügend. In diesen Fällen müssen Medikamente eingesetzt werden.
Eine LDL-C Reduktion um 1mmol/l führt zu einer Reduktion der koronaren Ereignisse um 23% und der vaskulären Ereignisse um 21% (9). Je tiefer der LDL-Cholesterinwert gesenkt wird, desto geringer ist das kardiovaskuläre Risiko. Dies gilt für jede Art der Lipidsenkung und für alle Patienten, ausser denjenigen mit einer Herzinsuffizienz unabhängig vom Ausgangswert des LDL-Cholesterins.
Sogar bei Patientengruppen, die mit einem medianen LDL-Cholesterinwert von 1.6mmol/l beginnen und einen Medianwert von 0.5mmol/l erreichen, gibt es eine konsistente relative Risikoreduktion für schwerwiegende vaskuläre Ereignisse pro LDL-C-Änderung von im Mittel 21%, ohne dass gegenläufige unerwünschte Effekte beobachtet werden. Diese Daten deuten darauf hin, dass eine weitere Senkung des LDL-C-Wertes über die niedrigsten derzeitigen Zielwerte hinaus das kardiovaskuläre Risiko weiter reduzieren würde (10).
Lipidsenkende Medikamente und ihre Wirkung
Statine sind die am häufigsten eingesetzten Lipidsenker. Sie sind die weltweit vermutlich am besten dokumentierten Medikamente. Statine reduzieren das LDL-Cholesterin um bis zu 50%. Fibrate sind alte Medikamente, die Triglyceride effektiv um ca. 30% senken. Sie werden bei Patienten eingesetzt, deren Triglyceridwerte trotz Diät nicht entscheidend gesenkt werden können und die ein erhöhtes Risiko für Pankreatitis haben. Austauscherharze wie Colestipol werden heute wegen der Nebenwirkungen kaum mehr verwendet. Ezetimibe senkt LDL-Cholesterin um ca. 20%. Es wird vor allem in Kombination mit Statinen eingesetzt, wodurch es einen ähnlichen Effekt hat wie eine dreifache Dosissteigerung. Die Antikörper gegen PCSK9 senken LDL-Cholesterin um ca. 60%. Sie senken zusätzlich das atherogene Lp(a) um ca.25%.
In den zwei Zulassungsstudien mit PCSK9-Hemmern, FOURIER mit Evolocumab und ODYSSEY OUTCOMES mit Alirocumab, konnte auch eine Reduktion der kardiovaskulären Ereignisse um ca. 15% gezeigt werden (11, 12). Bempedoinsäure ist ein neues Medikament, welches in der Schweiz demnächst die Kassenzulässigkeit erhalten wird. Es greift wie die Statine in die Synthese des Cholesterins ein. Bempedoinsäure (Nilemdo®) senkt LDL-Cholesterin um ca. 20%. Diese wird auch in einer Kombinationsform mit Ezetimibe (Nustendi®), die LDL-Cholesterin um ca. 40% senkt, auf den Markt kommen.
Erreichung der LDL-Zielwerte
Die Behandlung der Dyslipidämie richtet sich nach dem kardiovaskulären Risiko. Der Referent zeigte die Behandlunsalgorithmen für hohes und sehr hohes Risiko (siehe AGLA Pocket Guide 2020).
In der DAVINCI-Studie (13) war die Zielerreichung suboptimal. Insgesamt erreichten nur 54% der Patienten ihr risikobasiertes Ziel gemäss der ESC/EAS-Leitlinie von 2016, und bezüglich Zielen der ESC/EAS-Leitlinie von 2019 war dieser Wert noch niedriger (33%). Bei den Patienten mit ASCVD war die Zielerreichung noch geringer; während 30% LDL-C-Werte <1,8 mmol/L hatten, erreichten nur 18% – weniger als jeder Fünfte – LDL-C-Werte <1,4 mmol/L. Bei der Bewertung der ESC/EAS-Zielerreichung 2016 (LDL-C < 1,8 mmol/L) stieg diese erwartungsgemäss mit dem Einsatz von intensiven und hochintensiven Statinen (19-45%) und weiter mit der Kombinationstherapie (54% mit Ezetimibe und 67% mit PCSK9-Inhibitoren). Als das Ziel schwieriger zu erreichen war, d.h. <1,4 mmol/L (ESC/EAS-Ziel 2019), führte jedes Regime einschliesslich der Kombinationstherapie mit Ezetimibe zu einer Zielerreichung von etwa einem Fünftel.
In der SPUM-Studie in der Schweiz (14) wurden von 2521 Patienten nach 1 Jahr 93,2% mit Statinen (53% hochintensive Statine) und 7,3% mit Ezetimibe behandelt. 54,9% hatten eine atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung mit sehr hohem Risiko. LDL-C-Werte von weniger als 1,8 mmol/l und weniger als 1,4 mmol/l nach 1 Jahr wurden bei 37,5% bzw. 15,7% der Patienten beobachtet. Eine LDL-Senkung von 50% erreichten noch weniger Patienten. Nach Modellierung der Statin-Intensivierung und der Ezetimibe-Effekte stiegen diese Zahlen auf 76,1% bzw. 49%. Unter maximaler Statintherapie plus Ezetimibe hätten 39% der Patienten einen LDL-C-Wert zwischen 1,4 und 2,6 mmol/l erreicht (dies ist die Spanne, in der gemäss Limitatio kein PCSK9-Inhibitor verschrieben werden kann. 51% der Patienten wiesen einen LDL-C-Wert über 1.4 mmol/l auf.
Alter
Wenn man die Statinbehandlung bei Patienten über 75 Jahre und bei unter 75-Jährigen vergleicht, stellt man fest, dass die relative Risikoreduktion bei älteren etwa gleich gross ist wie bei jüngeren Patienten. Die absolute Risikoreduktion ist bei älteren Patienten sogar grösser als bei jüngeren.
Fazit
Der LDL-Cholesterinspiegel ist vorwiegend genetisch determiniert → Kaskaden-Screening bei familiärer Hypercholesterinämie
LDL-Cholesterin ist ein behandelbarer Risikofaktor
Die Zielwerte sollten erreicht werden (the lower the better), nötigenfalls mit einer Kombinationsbehandlung
Bei Unverträglichkeit der Statine, LDL-C Zielwert nicht erreicht trotz Statinen + Ezetimibe, PCSK9-Hemmer: Die Therapieinitiierung erfolgt u.a. über den Kardiologen, die Folgeverordnung wird vom Hausarzt ausgestellt.
Quelle: Online-Fortbildung Cardio Metabolic Update für die Praxis, 06.05.2021.
riesen@medinfo-verlag.ch